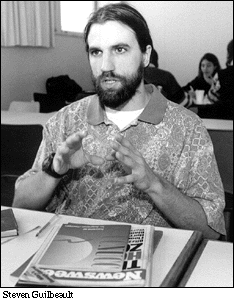 Au cours d'une conférence
qu'il a donnée au cégep de Shawinigan, dans la circonscription
électorale du premier ministre Jean Chrétien, Steven
Guilbeault a brandi le fameux livre rouge qui présente
le programme du Parti libéral du Canada. «On y promet
que les émissions de gaz à effet de serre seront
réduites de 20 % au pays. Non seulement elles ne diminuent
pas, mais elles augmentent», a-t-il dénoncé.
Au cours d'une conférence
qu'il a donnée au cégep de Shawinigan, dans la circonscription
électorale du premier ministre Jean Chrétien, Steven
Guilbeault a brandi le fameux livre rouge qui présente
le programme du Parti libéral du Canada. «On y promet
que les émissions de gaz à effet de serre seront
réduites de 20 % au pays. Non seulement elles ne diminuent
pas, mais elles augmentent», a-t-il dénoncé.
Pour cet environnementaliste qui a siégé à
trois reprises, à Genève et à Berlin, au
sein d'une division de l'ONU chargée d'appliquer la Convention
sur les changements climatiques, ce fléau pourrait provoquer
encore plus de dommages que les bouleversements qui ont mené
à la disparition des dinosaures. «C'est, selon l'ONU,
la pire menace à avoir pesé sur l'humanité»,
dit-il.
En 1988, un groupe de travail avait réuni 2000 spécialistes
mondiaux pour faire la lumière sur les changements climatiques.
Leur rapport, déposé deux ans plus tard, laissait
croire à un grave danger provoqué par l'activité
humaine. Mais ils faisaient savoir que d'autres études
étaient nécessaires. Elles ont été
menées et, grâce notamment aux données enregistrées
dans le nord canadien, leur second rapport, daté de décembre
1995, est catégorique: il faut agir vite.
«Le climat s'est réchauffé, en moyenne, de
0,3 à 0,6 °C sur le globe depuis le début de
l'ère industrielle, vers 1850, explique M. Guilbeault.
Cela peut paraître insignifiant, mais c'est très
grave, car certaines régions du monde se réchauffent
(au Canada notamment, on note une augmentation de 3 à 6
°C, soit 10 fois plus que la moyenne) alors que d'autres se
refroidissent, comme l'ont montré les vagues de froid en
Europe.»
Des bouleversements records
Tous ces changements provoquent des bouleversements météorologiques
non négligeables. Les compagnies d'assurances rapportent
que 1996 a été la pire année au chapitre
des catastrophes naturelles au Canada. Cela est principalement
dû au déluge du Saguenay, mais d'autres ont fait
des constats semblables: la multinationale de l'assurance Munich
Re signale dans son dernier rapport annuel que le nombre de catastrophes
naturelles a augmenté de 400 % chez ses clients.
À cause de ce réchauffement, on peut s'attendre
à connaître des pluies abondantes et subites après
une période de sécheresse, particulièrement
dans les régions côtières. Si tous ont en
tête les maisons emportées par les eaux à
Chicoutimi en juillet 1996, on oublie que la région de
Montréal avait connu l'année précédente
l'une des plus grandes sécheresses de son histoire. Pendant
ce temps, sur la côte ouest, tornades, ouragans et tempêtes
tropicales se succèdent à un train d'enfer.
«Quelque 130 pays ont approuvé le rapport du groupe
d'experts mandatés par l'ONU, explique Steven Guilbeault.
On ne conteste plus les données scientifiques. Le débat
s'est déplacé vers l'économie. On se demande
comment effectuer une transition vers le développement
durable sans trop ébranler l'économie. Nous travaillons
de plus en plus avec des économistes. Certains sont très
sensibles à ces questions.»
Un militant vert pur
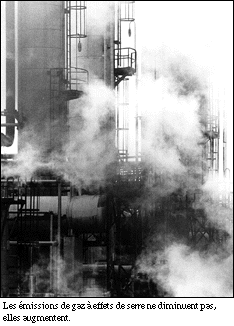 Étudiant à
la maîtrise en sociologie sous la direction de Jean-Guy
Vaillancourt (sujet de mémoire: le réchauffement
climatique), Steven Guilbeault est un militant écologiste
comme il ne s'en fait plus. Actuellement, il est président
de la Coalition québécoise sur les changements climatiques,
vice-président du Conseil régional de l'environnement
(Montréal), membre du Comité aviseur sur les négociations
internationales sur les changements climatiques, bénévole
au GRIP-Université de Montréal et à Greenpeace
et conférencier invité dans plusieurs régions
du Québec. Sans parler de ses travaux au sein de la délégation
canadienne à l'ONU... Ouf! On peut dire que lui n'économise
pas l'énergie.
Étudiant à
la maîtrise en sociologie sous la direction de Jean-Guy
Vaillancourt (sujet de mémoire: le réchauffement
climatique), Steven Guilbeault est un militant écologiste
comme il ne s'en fait plus. Actuellement, il est président
de la Coalition québécoise sur les changements climatiques,
vice-président du Conseil régional de l'environnement
(Montréal), membre du Comité aviseur sur les négociations
internationales sur les changements climatiques, bénévole
au GRIP-Université de Montréal et à Greenpeace
et conférencier invité dans plusieurs régions
du Québec. Sans parler de ses travaux au sein de la délégation
canadienne à l'ONU... Ouf! On peut dire que lui n'économise
pas l'énergie.
Tout en sonnant l'alarme, ce cédérom ambulant qui
cite des chiffres précis pour appuyer ses arguments refuse
de baisser les bras. «Il ne faut pas se leurrer. Des Saguenay,
il y en aura d'autres, ici ou ailleurs. Pire: quand on aura cessé
toute production de gaz à effet de serre, on en aura pour
100 ans à subir encore des bouleversements. Malgré
tout, les améliorations sont possibles, à la portée
de tous. Ce sont des gestes tout simples qui font la différence:
adhérer à un service de covoiturage, par exemple,
ou recycler son aluminium.»
Inutile d'essayer de rejeter la responsabilité sur les
pays du tiers-monde. Cette fois, la balle est dans le camp des
pays industrialisés, car ce sont eux qui contribuent le
plus, et de loin, au réchauffement climatique. Or, quelques
initiatives sont encourageantes. L'Inde, qui en avait assez de
dépendre du pétrole des autres, est devenue en quelques
années le deuxième producteur mondial d'énergie
éolienne. Ailleurs, c'est l'énergie solaire qui
fait une percée. Il faut suivre ces exemples.
Mathieu-Robert Sauvé
Steven Guilbeault a siégé à trois reprises
à la Conférence des parties, une division de l'ONU
chargée d'appliquer la Convention sur les changements climatiques.
«Je partage, avec deux autres représentants canadiens,
le siège réservé aux organismes non gouvernementaux.
Nous siégeons donc à tour de rôle. Cela ne
nous donne pas le droit de parole, mais nous sommes assis avec
la délégation et nous pouvons assister aux briefings
et aux rencontres non officielles qui ont lieu en marge de ces
rencontres internationales.»
Pour le militant, cela se passe à deux niveaux. Il doit
se faire entendre parmi les autres membres de la délégation
canadienne, composée des deux présidents (envoyés
par Environnement Canada et le ministère des Affaires extérieures
et du Commerce international), d'un représentant du ministère
des Ressources naturelles et de deux délégués
du secteur industriel. Et il doit défendre sa cause à
l'échelle internationale. «Il ne faut pas se faire
trop d'illusions quand on va à l'ONU, dit-il. Les changements
sont très lents, paraissent imperceptibles. Mais ce qu'on
adopte dans ces tribunes donne souvent le ton aux pays membres.
C'est le concept du "penser globalement, agir localement".»
Les journées commencent à sept heures et s'étirent
souvent tard dans la soirée. Les discussions de corridor
et les négociations officieuses sont constantes. «J'essaie
de faire valoir des arguments environnementalistes et de santé
humaine. C'est sûr que j'aurais plus de poids si j'étais
président de Shell Canada, mais je crois que notre contribution
est utile.»
Au nombre des petites victoires auxquelles il a participé
figure la reconnaissance, par 130 pays, du rapport scientifique
sur les changements climatiques en décembre 1995.