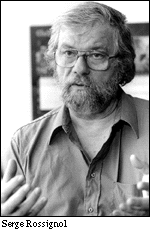
Pendant que la plupart des pays industrialisés, notamment
le Japon et les États-Unis, augmentent leur soutien à
la recherche fondamentale, le Canada diminue sa part et privilégie
le financement de la recherche en partenariat», déplore
le Dr Serge Rossignol, directeur du Centre de recherche en sciences
neurologiques de l'Université de Montréal.
Le Dr Rossignol fait partie du Conseil pour la recherche en santé
du Canada (CRSC), une coalition regroupant neuf établissements
de recherche, dont l'Institut neurologique de Montréal
et l'Institut de recherches cliniques de Montréal. Inquiet
de la diminution - annoncée avant le budget! - des subventions
accordées par le Conseil pour la recherche médicale
(CRM), ce regroupement a entrepris de sensibiliser les décideurs
politiques à l'importance de maintenir un financement adéquat
pour la recherche fondamentale dans le domaine biomédical
et de la santé.
«La création de la Fondation canadienne pour l'innovation
est une bonne nouvelle et ceci pourra avoir des retombées
bénéfiques même pour la recherche fondamentale,
reconnaît-il. Mais il aurait également fallu augmenter
les budgets des conseils subventionnaires. La Fondation force
un modèle de recherche en partenariat, ce qui n'apporte
rien à la personne du chercheur dans son laboratoire. Il
y a de très bonnes recherches qui ne seront pas admissibles
à ce type de financement.»
Un recul
Selon la réduction annoncée au budget du CRM, le
Canada aura réduit de 10 millions, en 1997-1998, sa contribution
au financement de la recherche universitaire biomédicale
par rapport à 1990. Au cours des quatre dernières
années, la réduction enregistrée a été
de 25 % alors que tous les autres pays du G7 augmentaient leur
financement dans ce domaine.
Les chiffres tirés du document de sensibilisation du CRSC
indiquent qu'entre 1990 et 1998 les États-Unis auront augmenté
leur financement de la recherche en santé de 55,8 %, le
Royaume-Uni de 38,6 %, la France de 40,4 %, l'Allemagne de 37,9
% et l'Australie de 48,5 %. Quant au Japon, il investira un surcroît
de 155 milliards de dollars américains dans les différents
domaines de la recherche universitaire au cours des cinq prochaines
années, ce qui représente une augmentation de 50
% par rapport à maintenant.
Le Canada sera quant à lui à -1,4 % du taux de 1990
alors que les subventions provenant du CRM atteignaient 242 millions
de dollars.
Création d'emplois
Toujours selon les chiffres du CRSC, chaque augmentation de un
million de dollars versée par le CRM crée 62 nouveaux
emplois. Ces subventions ont par ailleurs un effet d'entraînement.
Depuis 1994, environ 1000 emplois directs et 3000 emplois indirects
auraient été créés par des entreprises
associées aux projets financés par le CRM, même
si les projets n'étaient pas directement en lien avec les
applications commerciales auxquelles ils ont donné lieu.
«La masse critique de nouvelles connaissances acquises grâce
à ces recherches [universitaires] a attiré des investissements
du secteur privé, abouti à la création d'entreprises
et permis la création d'emplois de haut niveau»,
fait valoir le CRSC.
Au cours des 13 dernières années, 156 entreprises
auraient été créées au Canada grâce
aux découvertes réalisées par les principaux
établissements universitaires du pays; 29 d'entre elles
ont été créées dans la seule année
de 1994, alors que le financement dans le domaine biomédical
et de la santé connaissait une augmentation d'environ 8
%.
Le CRSC estime également que les établissements
universitaires de recherche sont en soi d'importants employeurs
puisque l'on dénombre quelque 45 000 chercheurs, techniciens
et employés de soutien dans ces différentes maisons
au Canada, ce qui est supérieur au nombre d'employés
de la plus grande entreprise canadienne, General Motors.
Parmi les 250 entreprises de biotechnologie canadiennes comptant
plus de 8000 employés, on retrouve 62 entreprises liées
aux secteurs public et parapublic tels hôpitaux et universités.
Malgré cela, le Canada tirait déjà la patte
en 1992 alors qu'il se situait derrière les principaux
pays de l'OCDE avec un taux de chercheurs de 5,2 pour 1000 habitants,
contre 7,6 aux États-Unis et 9,5 au Japon.
Demeurer compétitif
 La diminution du financement
public fait peser des risques sur les progrès enregistrés
ces dernières années, craignent les membres du CRSC.
«Réduire les subventions de recherche fédérales
revient littéralement à se couper l'herbe sous les
pieds», affirment-ils.
La diminution du financement
public fait peser des risques sur les progrès enregistrés
ces dernières années, craignent les membres du CRSC.
«Réduire les subventions de recherche fédérales
revient littéralement à se couper l'herbe sous les
pieds», affirment-ils.
Parmi les effets néfastes appréhendés, ils
soulignent que les scientifiques canadiens seront tentés
de s'établir à l'étranger, que les carrières
scientifiques auront moins d'attrait sur les étudiants
qualifiés, que le Canada prendra du retard sur ses concurrents,
décrochera moins de contrats, attirera moins de capitaux
à risque et perdra des milliers de postes de haut calibre.
La Fondation canadienne pour l'innovation vient toutefois pallier
au moins une des craintes exprimées, soit la dégradation
des infrastructures de recherche.
Serge Rossignol considère par ailleurs comme une très
bonne nouvelle le maintien des Réseaux des centres d'excellence
(RCE). Selon l'information provenant du RCE en neurosciences,
ces réseaux auraient même reçu, en marge du
budget Martin, leur consécration comme structure permanente.
«Le discours de Paul Martin, dans lequel la recherche universitaire
est très présente, témoigne d'une reconnaissance
des besoins de ce secteur, estime le chercheur. Mais les mesures
annoncées ne comblent pas tous les besoins et l'action
du Conseil pour la recherche en santé demeure pertinente
et nécessaire.»
Daniel Baril