«Une somme d'institutions totalitaires ne peut pas
engendrer la démocratie», affirme Omar Aktouf.
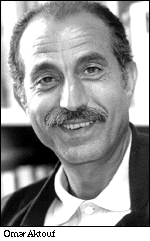 Le salarié ne doit plus
être considéré comme un coût à
combattre, mais comme un allié à convaincre, sinon
à séduire.» Omar Aktouf, professeur au Service
de l'enseignement de la direction et de la gestion des organisations
à l'École des Hautes Études Commerciales,
apporte une note discordante dans la trop belle unanimité
du discours «économiste» et «managérial»
actuel.
Le salarié ne doit plus
être considéré comme un coût à
combattre, mais comme un allié à convaincre, sinon
à séduire.» Omar Aktouf, professeur au Service
de l'enseignement de la direction et de la gestion des organisations
à l'École des Hautes Études Commerciales,
apporte une note discordante dans la trop belle unanimité
du discours «économiste» et «managérial»
actuel.
Le professeur fait une critique virulente de l'approche traditionnelle
en gestion - engagée dans une voie sans issue par la recherche
du profit maximal - à laquelle il oppose une approche résolument
humaniste, centrée sur «l'émancipation du
capital humain».
Son analyse est longuement exposée dans un ouvrage de base
abondamment documenté, Le management entre tradition et
renouvellement, dont la récente traduction anglaise (1)
s'ajoute aux éditions espagnole et portugaise. Dans cette
discipline, une traduction du français à l'anglais
est en soi un événement puisque l'on ne connaît
qu'un seul autre cas, celui d'Henri Fayol en 1916.
Une crise structurelle
D'entrée de jeu, Omar Aktouf lance une première
pierre en soutenant que le management n'est pas une science mais
une idéologie. «Le management cherche à influer
sur les comportements des gens et le cours des événements
pour répondre au besoin de rentabilité du possédant,
affirme-t-il. Ceci n'a rien à voir avec une science.»
Si leur discipline n'est pas une science, la raison d'être
des gestionnaires n'est pas non plus de créer de l'emploi.
«C'est une autre mystification, lance le professeur. L'employeur
ne donne pas d'emploi; il a plutôt besoin d'employés
pour assurer son profit. Cela fait partie de l'idéologie
du gestionnaire de justifier sur le plan moral - par la réponse
à des besoins sociaux - quelque chose de purement financier.»
Le caractère non scientifique du management n'est pas étranger
à l'état de crise profond que traverse l'industrie
nord-américaine: «La réflexion est remplacée
par le calcul et notre "mentalité managériale"
tient un discours contradictoire. D'une part, on martèle
l'employé en lui disant que l'on a absolument besoin de
lui et de son intelligence et, d'autre part, on se débarrasse
de lui dès que ça va mal. Le capital humain n'a
jamais été si maltraité que depuis que l'on
dit qu'il est précieux!»
Les nouvelles approches, du genre qualité totale et norme
ISO, n'apparaissent aux yeux du critique que comme des gadgets
destinés à maintenir le statu quo tayloriste selon
lequel l'employé est un objet. «Cette contradiction
ronge nos organisations», soutient-il.
La crise actuelle lui apparaît donc une crise structurelle
quasi inévitable et non une crise conjoncturelle, comme
le laissent entendre les économistes. «Selon la pensée
néolibérale, les lois de la concurrence doivent
tout diriger. Il en résulte cet autre paradoxe: "Faisons
tous la guerre contre tous et nous nous porterons mieux..."»
Le professeur pourfend du même souffle l'idée selon
laquelle le néolibéralisme serait le sauveur de
la démocratie. «Pour Montesquieu, rappelle-t-il,
la notion de démocratie reposait sur la séparation
des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire;
lorsque ces pouvoirs ne sont pas séparés, nous avons
le totalitarisme. C'est le cas de l'entreprise privée,
où tous les pouvoirs sont entre les mains des patrons.
Comment une somme d'institutions totalitaires pourrait-elle engendrer
la démocratie?» L'entreprise doit donc passer du
«monarchisme au républicanisme».
Allemagne, Suède et Japon
Omar Aktouf est convaincu que les choses pourraient se faire autrement,
notamment par la cogestion, et s'appuie entre autres sur les exemples
du Japon, de la Suède et de l'Allemagne. En Suède,
nous apprend l'auteur, un loi garantit la sécurité
d'emploi et les entreprises doivent consacrer 20 % des profits
à l'amélioration des conditions de travail.
En Allemagne, la cogestion entre État, entreprise et syndicat
est inscrite dans la Constitution. La stabilité et les
politiques sociales progressistes qui ont en découlé
n'ont connu de déclin qu'avec l'abandon de la social-démocratie
dans les années 1980.
Au Japon, la gestion par consensus fait partie de l'âme
du pays; le bien-être général prime sur le
capital financier, les écarts de salaires sont faibles,
l'emploi à vie est assuré et le patron peut aussi
être le président du syndicat... «Toyota n'a
jamais fait un seul chômeur», soutient Omar Aktouf.
«Ces pays ont élaboré des modes de gestion
et d'organisation du travail qui ne se sont pas construits aux
dépens des salariés, écrit-il. Rien n'empêche
qui que ce soit de faire comme eux. N'importe quelle entreprise
peut différer les profits, réinvestir sans cesse,
donner l'emploi à vie, réduire la différence
entre les salaires, associer les employés aux décisions,
se préoccuper de leur sort [...]»
Cette recette semble efficace même sur le plan de la production
puisque, selon l'auteur, les produits nord-américains seraient
rapidement déclassés par les produits des pays adoptant
des politiques sociales progressistes si les mesures protectionnistes
internationales étaient abolies.
Malheureusement, déplore-t-il, on se contente trop souvent
d'importer des morceaux de gestion comme s'il s'agissait de recettes
miracles sans remettre en question la philosophie qui nous guide.
Une révolution à faire
La critique d'Omar Aktouf vise également le monde syndical.
«Notre syndicalisme revendicateur n'est pas approprié
dans un cadre participatif», déclare-t-il. Mais il
ajoute que «l'on a le syndicalisme que l'on mérite
puisque l'entreprise précède toujours le syndicat.
Les changements doivent donc venir d'abord du patronat.»
Des initiatives comme l'expérience de gestion de la compagnie
Cascades le réjouissent donc et lui donnent espoir. Cette
papeterie se distingue par un style de gestion convivial, une
décentralisation maximale, une réduction des postes
de contrôle, une grande autonomie accordée aux employés,
un partage des profits. «Même si l'on est encore loin
de la prise en main de la gestion par le travailleur, aucun syndicaliste
ne pourrait soutenir que Bernard Lemaire est l'ennemi»,
estime Omar Aktouf.
L'exemple de Cascades constitue par contre une exception qui «fonctionne
malgré le système». Pour que ce modèle
se généralise, un changement radical est nécessaire:
les gouvernements doivent être davantage interventionnistes
tout en évitant la «réglementations tatillonnes»;
les syndicats doivent être plus coopératifs «avec
les patrons qui le méritent»; les entreprises concurrentes
doivent collaborer pour éviter la duplicité dans
leur secteur; les besoins fondamentaux des citoyens (éducation,
santé, logement, etc.) doivent demeurer en dehors des considérations
de profits; la production ne doit pas engendrer de pollution;
les profits, soumis à l'impôt, ne doivent pas créer
«indûment» de chômage; le salariat dans
sa forme actuelle doit être aboli pour être remplacé
par le partage des bénéfices.
 Ce programme est une véritable
révolution, convient Omar Aktouf, et c'est à l'État
qu'il revient de prendre l'initiative. «Les gouvernements
ne peuvent continuer de penser en hommes d'affaires, sinon privatisons-les!
Tous les pays devront négocier un nouveau contrat social
pour éviter une révolution sanglante. Nous avons
une longueur d'avance au Québec, ne la perdons pas.»
Ce programme est une véritable
révolution, convient Omar Aktouf, et c'est à l'État
qu'il revient de prendre l'initiative. «Les gouvernements
ne peuvent continuer de penser en hommes d'affaires, sinon privatisons-les!
Tous les pays devront négocier un nouveau contrat social
pour éviter une révolution sanglante. Nous avons
une longueur d'avance au Québec, ne la perdons pas.»
Omar Aktouf travaille présentement à un ouvrage
consacré à la pensée néolibérale.
Ce sera assurément un pavé dans la trop rassurante
tranquillité de «l'idéologie dominante».
Soulignons que, par souci de cohérence, l'auteur verse
les recettes de ses volumes au fonds de recherche du groupe Humanisme
et gestion des HEC.
Daniel Baril
(1) Omar Aktouf, Traditional Management and Beyond, Boucherville,
Gaëtan Morin éditeur, 1996, 256 pages, 65 $.