Volume 35 numéro 16 15 janvier 2001 |
Adaptation
psychosociale: la «science de la prévention» prend
forme
Frank
Vitaro et Claude Gagnon publient le premier ouvrage sur les données
d’une vingtaine d’interventions en matière de prévention
chez les jeunes.
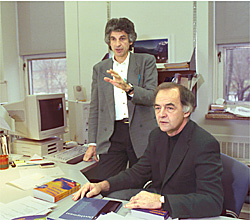 |
|
Depuis quelques
années, une nouvelle discipline est en train d’émerger
aux confins de la psychopathologie, de la criminologie, de l’épidémiologie
et de la psychologie du développement. Comme son nom l’indique,
la «science de la prévention» vise à prévenir,
plutôt qu’à guérir, les problèmes
d’adaptation psychosociale et de santé mentale chez les
enfants et les adolescents.
Deux professeurs de l’École de psychoéducation,
Frank Vitaro et Claude Gagnon, viennent d’apporter une contribution
majeure à cette nouvelle discipline en publiant, en deux volumineux
ouvrages collectifs de 600 pages chacun, les données les plus
récentes tirées d’une vingtaine de recherches effectuées
principalement aux États-Unis et au Québec dans le domaine
de la prévention.
«Il n’y avait absolument rien du genre ni en français
ni en anglais», assure Claude Gagnon, directeur de l’École
de psychoéducation.
La science de la prévention est en fait la systématisation
de l’intervention psychosociale afin d’en maximiser l’impact.
Elle repose sur l’étude descriptive des problèmes,
leur épidémiologie, la recherche des causes, la désignation
des facteurs précurseurs et l’expérimentation d’actions
ciblées faisant l’objet d’un plan de mise en oeuvre,
d’un suivi et d’une évaluation.
«Toutes les études que nous présentons respectent
ces exigences et reposent sur des modèles théoriques
reconnus, souligne Frank Vitaro. Les intervenants seront ainsi en
mesure d’évaluer quels programmes sont les plus efficaces
et comment procéder pour espérer des résultats
similaires.»
Une perspective ouverte
Alors que deux courants d’idées s’affrontent dans
le domaine de la prévention, soit l’approche universelle
et l’approche ciblée, les directeurs de l’ouvrage
ont voulu éviter le piège d’un débat stérile
en répertoriant des programmes relevant des deux approches.
«La prévention universelle —comme une campagne de
promotion de la santé — vise tous les membres d’une
population, alors que la prévention ciblée — telle
une intervention en toxicomanie — vise des groupes déjà
désignés comme étant plus particulièrement
à risque, explique Frank Vitaro. Chaque approche a ses mérites
et il n’y a pas d’incompatibilité théorique
entre elles.»
Idéalement, les deux approches devraient être combinées
dans une stratégie mixte lorsque les conditions le permettent.
Selon le professeur Vitaro, c’est le cas présentement:
«Il n’y a de chicane entre les tenants des deux approches
que lorsqu’il manque de ressources financières pour aller
dans les deux sens, affirme-t-il. Actuellement, nous sommes revenus
à une situation de vaches grasses et il faut en profiter pour
investir dans les deux approches.»
L’orientation retenue par l’ensemble des études présentées
mise également sur une nouvelle conception de la prévention
qui commande d’intervenir de façon variable selon les
moments critiques du développement psychosocial du jeune.
«La méthode d’intervention doit être à
la fois omnibus et particulière, poursuit M. Vitaro. On entend
par “omnibus” une méthode qui vise à rectifier
l’ensemble du comportement de l’enfant. Ceci repose sur
la constatation qu’un problème de comportement apparaît
souvent en cooccurrence avec un autre, comme la délinquance
et le suicide. Ces problèmes ont alors des facteurs de risque
communs; une intervention omnibus prendra en compte l’ensemble
de la problématique en agissant sur l’enfant tout en mettant
à contribution la famille, l’école et le milieu
communautaire.»
«L’intervention particulière vise pour sa part un
problème circonscrit, comme le décrochage, la toxicomanie
ou le comportement violent. Avant, on se limitait à faire de
la prévention chez les enfants à risque en pensant que
tout irait bien par la suite. Maintenant, nous savons qu’il faut
maintenir durant l’adolescence des interventions particulières.»
Une autre dimension de l’approche est que, même si elle
mise sur la prévention, l’aspect curatif n’est pas
pour autant délaissé. «Une campagne de prévention
contre le cancer n’enlève pas la nécessité
des soins thérapeutiques pour ceux qui en sont atteints»,
fait valoir Claude Gagnon.
1150 pages!
En faisant le point sur les connaissances les plus récentes
résultant d’études effectuées parfois sur
plusieurs décennies, l’ouvrage s’adresse à
la fois «aux intervenants psychosociaux qui pourront disposer
d’un guide méthodologique leur permettant d’éviter
les lacunes repérées par les expérimentations,
et aux étudiants en formation qui auront accès à
toutes les données nécessaires pour concevoir des programmes
d’intervention de qualité», souligne le directeur
de l’École.
Les 22 études retenues, mettant à contribution 42 auteurs,
sont regroupées en deux grands ensembles faisant l’objet
d’un tome chacun, soit les problèmes internalisés
et les problèmes externalisés. Les premiers font référence
aux troubles comportementaux qui se retournent contre le sujet, comme
l’anxiété, la dépression, les idées
suicidaires, les séquelles d’agressions sexuelles, etc.;
les seconds désignent les comportements déviants dirigés
contre les autres ou contre l’environnement, comme la violence,
la délinquance, les comportements à risque (psychotropes,
jeux), etc. Le premier tome présente également quatre
textes d’éléments conceptuels et stratégiques.
«Le découpage en catégories distinctes est un
peu artificiel parce que les problèmes ne sont jamais isolés,
prévient Frank Vitaro. Cette organisation du contenu répond
d’abord à une nécessité pratique.»
La vision unifiée des problèmes d’adaptation et
des programmes de prévention fait d’ailleurs l’objet
de la conclusion générale des deux tomes.
Si la science de la prévention est une nouvelle discipline,
elle semble avoir connu un développement remarquable en quelques
années à peine; une première édition en
1994 des travaux effectués dans ce domaine totalisaient 200
pages. Sans prétendre être exhaustif, l’ouvrage
que publient aujourd’hui Frank Vitaro et Claude Gagnon fait 1150
pages.
Daniel Baril
![]()

