Volume 35 numéro 13 27 novembre 2000 |
Pour
y voir clair dans les élections américaines
Les
tendances qu’on y observe se font également sentir au
Canada, selon Pierre Martin.
 |
|
Vous y comprenez
quelque chose aux élections américaines? Ne vous en
faites pas, vous n’êtes pas les seuls. Pour vous aider
à y voir un peu plus clair, Forum a rencontré
Pierre Martin, professeur au Département de science politique
et qui était professeur invité à l’Université
Harvard l’an dernier pendant les préparatifs des présidentielles
américaines.
Pour le politologue, qui a effectué ses études doctorales
à l’Université North Western de Chicago, le Canada
et le Québec auraient beaucoup à tirer de l’analyse
des événements sur les scènes politique et sociale
aux États-Unis puisque les tendances qu’on y observe se
font également sentir ici. Trois de ces tendances émergent
de la confusion électorale actuelle: la politique n’échappe
pas à la judiciarisation extrême de la société
américaine, deux notions de démocratie s’affrontent
et les partis courtisent le même électorat centriste.
Alors que plusieurs se questionnent sur le rôle et la pertinence
d’un collège électoral dans le processus d’élection
du président, Pierre Martin rappelle que cette institution
aujourd’hui archaïque a été créée
pour répondre à une situation historique donnée
(voir l’encadré). À son avis, l’abolition
de ce collège électoral au profit du suffrage universel
direct risquerait de créer des imbroglios encore pires que
celui que l’on connaît. «En cas de résultat
serré, c’est à l’échelle de tout le
pays qu’il faudrait alors refaire le comptage», croit-il.
La modification de l’actuel système électoral ne
lui semble d’ailleurs pas envisageable à brève
échéance puisqu’il faudrait amender la Constitution
américaine, ce qui n’est pas plus facile qu’au Canada:
«Plus du tiers des États tirent des avantages de ce système
et ils vont bloquer les amendements qui leur feraient perdre ces avantages»,
affirme le professeur.
Démocratie directe ou représentative?
Mais ce qui retient surtout l’attention de Pierre Martin, ce
sont les deux notions de démocratie qui s’affrontent actuellement
par tribunaux interposés. Les arguments invoqués de
part et d’autre pour refuser les résultats montrent que
nous sommes en présence de deux conceptions de la démocratie:
la démocratie représentative et la démocratie
directe.
«Pour les républicains, les premiers résultats
étaient valides et le processus était terminé
parce que tout s’était déroulé selon les
règles convenues par les partis. Pour les démocrates,
la justice doit être une justice de résultat et ils ont
tendance à vouloir accorder le même poids à tous
les électeurs. Aux yeux de Gore, les injustices soulevées
par certains citoyens concernant le bulletin de vote autorisent un
recomptage.»
Ces approches influent également sur la perception des règles.
Alors que Bush fait valoir que le décompte mécanique
protège de la subjectivité d’un décompte
manuel, les démocrates considèrent que le décompte
mécanique peut entraîner des erreurs pouvant être
corrigées par l’intervention humaine. Mais tout cela illustre
aussi le fait qu’en politique «il n’y a pas de place
pour le perdant, ajoutera le professeur. Les deux modes de comptage
sont sujets à des erreurs et il importe de réfléchir
à la mécanique électorale, tant celle des États-Unis
que celle du Canada, où prévaut le principe de “une
personne, un vote”.»
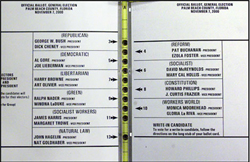 |
Comme on peut le constater, le bulletin de vote de la Floride pouvait porter à confusion. |
Selon Pierre Martin, les Américains s’intéressent d’ailleurs à la procédure canadienne, où l’uniformisation du processus permet d’éviter les erreurs ou injustices pouvant découler d’un système où chaque État a sa propre loi électorale, même pour les élections fédérales. En Floride, par exemple, la disposition des noms des candidats et des cases sur le bulletin de vote aurait induit plusieurs électeurs en erreur, au détriment du candidat démocrate.
Concurrence malsaine
Le recours aux tribunaux pour régler de tels différends
constitue «une démonstration frappante que la sphère
politique n’échappe pas au phénomène de
la judiciarisation des relations sociales», reprend le politologue.
À son avis, cette tendance commence également à
s’observer au Canada, comme peut le montrer le renvoi à
la Cour suprême pour déterminer si le Québec peut
accéder à la souveraineté.
Paradoxalement, les tensions sont très vives aux États-Unis
entre le Parti républicain et le Parti démocrate même
si leurs programmes politiques tendent à se rapprocher et alors
que le clivage est moins grand au sein de l’électorat.
«Les deux partis convoitent l’électorat médian,
qui est de plus en plus difficile à convaincre. Cela crée
une concurrence malsaine faisant porter l’enjeu sur la moralité
du candidat. La droite religieuse, qui constitue le noyau dur de l’électorat
républicain, est convaincue que les démocrates n’ont
pas la fibre morale pour diriger le pays, sans égard à
leur programme politique.»
C’est une autre tendance qui s’observe aussi au Canada.
Pour l’Alliance canadienne, les libéraux sont moralement
inaptes à diriger le pays et les libéraux soutiennent
la même chose à l’égard de leurs adversaires.»
Il y aurait ainsi plusieurs enseignements à tirer de l’analyse
comparative des situations américaine et canadienne, estime
le professeur. «Il est étonnant, conclut-il, que l’Université
de Montréal, qui compte trois instituts d’études
européennes, n’en ait aucun sur les États-Unis.»
Daniel Baril
Tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les «grands électeurs»
Le président
américain est élu par un collège électoral
composé de 538 «grands électeurs». Le nombre
de grands électeurs attribué à un État
est égal au nombre de représentants et de sénateurs
dont dispose cet État au Congrès (donc proportionnel
à sa population).
Ils ont été préalablement désignés
par les partis ou par l’État et leur fonction se limite
à la durée de la campagne électorale. En principe,
leur vote doit aller au candidat ayant obtenu la majorité au
suffrage universel exprimé par les électeurs qu’ils
représentent.
«Ce système a été mis en place au moment
de la création de l’État fédéral,
qui regroupait des colonies disparates, explique Pierre Martin. À
cette époque, les partis politiques n’existaient pas,
pas plus que les moyens de communication actuels. On doutait que la
population puisse vraiment connaître les candidats à
la présidence. Il paraissait préférable de faire
voter les gens pour des représentants locaux que chacun pouvait
connaître et qui délibéreraient afin de décider
quel candidat ils allaient appuyer en tenant compte des désirs
de la base.»
Cette fonction de délibération a été abandonnée
après une vingtaine d’années, alors que sont apparus
les partis politiques. Certains États ont à ce moment
adopté des dispositions obligeant les grands électeurs
à respecter le vote majoritaire des électeurs de la
base. Au Maine et au Nebraska, le vote des grands électeurs
doit être proportionnel à celui que chaque candidat a
reçu.
«Le collège électoral a été conservé
parce qu’il permettait également d’assurer un équilibre
politique entre les petits et les grands États, reprend le
politologue. Il s’agit là d’un principe fédéraliste
évitant aux petits États d’être noyés
et leur permettant d’avoir du poids dans l’élection
du président. Si les grands électeurs ne respectaient
pas la règle convenue, ils provoqueraient une crise constitutionnelle
grave.»
Lors de la dernière élection, le Nouveau-Mexique disposait
par exemple de cinq grands électeurs pour 600 000 votes exprimés,
alors que la Floride en avaient 25 pour six millions de votes exprimés.
La recherche d’équilibre peut ainsi causer un autre déséquilibre
en permettant à un candidat de remporter le suffrage universel
sans obtenir la majorité des grands électeurs, ou l’inverse.
C’est un genre de problème que nous connaissons bien avec
le processus électoral parlementaire canadien.
Daniel Baril
![]()

