Volume 35 numéro 10 6 novembre 2000 |
Une
bibliothèque bien particulière
La
matériauthèque de la Faculté de l’aménagement
comprend plus de 8000 échantillons de matériaux.
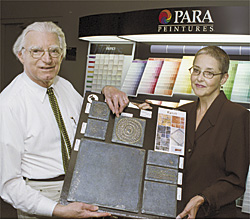 |
|
Une maison anglaise,
un stade en Norvège, une école en Autriche, une chapelle
américaine... Ces différentes constructions ont en commun
le bois, un matériau traditionnel qui, grâce aux innovations
technologiques, a acquis plus de souplesse dans les formes et une
résistance accrue à la charge. Le lamellé-collé,
par exemple, un contreplaqué d’épaisseurs variées,
est reconnu pour ces avantages.
Un échantillon de ce type de bois se trouve à la matériauthèque
de la Faculté de l’aménagement, où plus
de 8000 spécimens de matériaux sont entreposés.
Des centaines de fournisseurs renouvellent régulièrement
les échantillons de tissus, marbres, céramiques, revêtements
vinyliques, membranes de toit et isolants afin que les étudiants
soient à l’affût des nouveautés sur le marché.
«C’est une bibliothèque bien particulière,
dit la documentaliste Katia Mayer. Ici, il n’y a pas de livres,
mais des sections de cloisons, des cadres de fenêtres, des briques
et du béton. Cela permet aux étudiants de voir en trois
dimensions les divers matériaux illustrés dans les catalogues
et de mieux comprendre leurs propriétés physiques.»
Mais l’intérêt de la matériauthèque
ne s’arrête pas là. Elle fournit aussi une foule
de renseignements d’ordre pratique, souligne Collin Davidson,
professeur depuis 1968 à l’École d’architecture
et responsable de la matériauthèque. Par exemple, l’étudiant
a accès à de l’information et à des devis
qui lui indiquent le détail des travaux, la nature des matériaux
et les délais d’exécution. «La matériauthèque
est un outil d’aide à l’enseignement et à
la recherche», affirme M. Davidson.
Un complément à l’information théorique
D’où vient l’idée d’une bibliothèque
de matériaux? «Antérieurement, chaque département
de la Faculté avait sa propre matériauthèque,
raconte le professeur Davidson, mais faute de ressources aucune n’était
vraiment fonctionnelle. Il devenait urgent de trouver une solution
qui permette d’améliorer l’efficacité de ces
centres de documentation.» En 1998, le doyen de la Faculté
de l’aménagement, Michel Gariépy, l’a approché
pour mener une étude à ce sujet. Après une visite
de la cartothèque du Département de géographie
et de plusieurs matériauthèques, dont celles du Cégep
du Vieux-Montréal et de l’École d’architecture
en France, M. Davidson recommande entre autres de regrouper les quatre
bibliothèques de matériaux dans un seul et même
lieu.
Celui qu’on nomme le «loup blanc» dans le milieu
admet qu’un formidable concours de circonstances a favorisé
la réalisation du projet: le bâtiment de la Faculté,
qui fête cette année ses 30 ans, était alors en
rénovation. De plus, la proposition appuyait le plan d’abolition
des cloisons entre les départements, une préoccupation
commune à MM. Gariépy et Davidson. À force de
travail et de persuasion pour rallier les plus réticents, la
matériauthèque prend forme un an plus tard et soulève
un enthousiasme unanime.
Pour M. Davidson, qui rêve d’ouvrir le centre à
un public plus large, notamment les professionnels, la structure actuelle
a donné raison à cet engouement. Les étudiants
des différentes écoles de la Faculté utilisent
assidûment la matériauthèque comme complément
à l’information théorique. Avec ses 279 m2, incluant
deux bureaux et deux salles d’entreposage, la bibliothèque
de matériaux accueille même des étudiants d’autres
départements et établissements.
«L’an dernier, la matériauthèque a été
le clou de la visite de cégépiens à la Faculté»,
affirme Katia Mayer.
Le défi du classement
Pourtant, une ombre se profile à un moment sur le projet: comment
instaurer un classement des matériaux qui profite à
tous? Voilà la question que se posent M. Davidson et Mme Mayer.
C’est que les architectes ont recours à un système
connu sous le nom de «répertoire normatif» (qui
désigne les 16 divisions de la construction: plomberie, électricité,
isolation, etc.), alors que les designers industriels utilisent un
classement basé selon les différents types de matériaux:
bois, plastique, verre, pierre…
«Une fenêtre d’aluminium intéresse les architectes
parce que c’est une fenêtre, mais les designers s’y
intéressent parce qu’elle est faite en aluminium, illustre
le directeur. D’où le problème d’élaborer
un seul classement pour les deux disciplines.» Le professeur
se montre toutefois confiant: avec l’installation du programme
informatique Access, il sera bientôt possible d’établir
le passage entre les deux méthodes de classement.
Mais un vrai travail de bénédictin attend Mme Mayer
puisque, après avoir répertorié les 8000 échantillons,
toute une phase de travail restera à accomplir, dont le maintien
à jour des données et l’informatisation des catalogues.
Un boulot que la documentaliste connaît bien. Avant d’être
engagée par la Faculté de l’aménagement,
elle a travaillé pendant 20 ans au centre de documentation
du Département de sociologie.
«Le gros du travail devrait être terminé d’ici
l’automne prochain, assure-t-elle. À la matériauthèque,
deux terminaux seront à la disposition des étudiants.
Grâce à Internet, ils pourront même consulter de
chez eux les données des catalogues et, éventuellement,
avoir accès à des images numérisées des
échantillons.»
Dominique Nancy
![]()

