Volume 36 numéro 10 6 novembre 2000 |
70%
des étudiants ont de la difficulté à conjuguer
les verbes!
Un
centre de communication écrite sera créé d’ici
l’automne 2001.
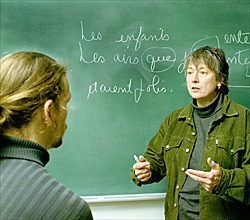 |
|
À l’automne
2001, tous les nouveaux étudiants qui feront leur entrée
à l’Université de Montréal devront subir
un test de français. «Il s’agira d’un test
diagnostique, précise la vice-rectrice à l’enseignement
de premier cycle et à la formation continue, Claire McNicoll.
Il permettra aux étudiants de s’évaluer de façon
précise. Ceux qui le voudront pourront s’inscrire, par
la suite, à des cours de rattrapage.»
Un centre de communication écrite sera créé d’ici
là pour permettre aux nouveaux d’avoir accès à
des cours sur mesure. Cette initiative s’appuie sur une étude
menée par une équipe de chargés de cours de la
Faculté de l’éducation permanente (FEP) qui révèle
des données surprenantes sur la maîtrise de la langue
chez les étudiants de l’Université de Montréal.
Selon cette étude, plus de 70% d’entre eux ont des problèmes
à conjuguer les verbes, mais la première source de difficulté
concerne le vocabulaire: de 75% à 87% des étudiants
admettent ressentir «parfois», «souvent» ou
«très souvent» des lacunes sur ce plan.
Écrire des textes représente une véritable épreuve
pour eux puisque de 49% à 64% des répondants, selon
l’unité à laquelle ils sont rattachés, disent
éprouver de la difficulté à structurer des textes.
Par ailleurs, plus du tiers des 1156 étudiants interrogés
entre novembre 1999 et janvier 2000 (37%) ont admis ne jamais consulter
d’ouvrages de référence pour résoudre leurs
problèmes grammaticaux.
«Il s’agit d’une étude sur la perception que
les étudiants ont d’eux-mêmes, signale Chantal Gamache,
qui donne des cours de «mise à niveau» en français
depuis plusieurs années et préside le Syndicat des chargées
et chargés de cours de l’Université de Montréal.
Nous voulions aller plus loin que les études habituelles, qui
ne tiennent pas compte de ce que les gens concernés pensent
du problème.»
Zone d’interprétation
La perception que les étudiants ont d’eux-mêmes
comporte tout de même une zone d’interprétation
qu’il faut analyser avec discernement. «Ce ne sont pas
toujours ceux qui disent avoir le plus de problèmes qui en
ont effectivement le plus, indique Mme Gamache. Parfois, le seul fait
d’admettre une lacune est le début d’un effort pour
la combler.»
L’étude note toutefois que «d’autres indices
montrent que les étudiants minimisent leur besoin d’aide:
60,6% des étudiants qui confondent “souvent” les
relatifs “dont”, “que” et “duquel” et
56,8% des étudiants qui disent éprouver “souvent”
de la difficulté à employer correctement les signes
de ponctuation dans leurs textes estiment n’avoir besoin que
d’un peu d’aide en français. Il nous semble donc
que la case “un peu” devrait être interprétée
comme “oui, j’ai besoin d’aide”.»
Sur la façon dont cette aide doit être offerte aux étudiants,
l’étude des chargés de cours représente
une douche froide pour les adeptes de l’enseignement à
distance. «Les étudiants qui disent avoir énormément
besoin d’aide en français préfèrent les
cours de 45 heures (25,7%) et l’aide individuelle (20%), dit
l’étude. La case offrant des cours par correspondance
ou par Internet reçoit le moins de faveur chez les étudiants:
5,7%.» Les réponses vont dans le même sens chez
les étudiants qui disent avoir besoin d’«un peu»
d’aide.
«Les étudiants rejettent donc, dans l’ensemble,
les cours par correspondance ou par Internet et les cours à
distance avec, à l’occasion, des rencontres de groupe,
soulignent les auteurs. Comme on ne peut expliquer ces choix en accusant
les étudiants d’être réfractaires aux nouvelles
technologies — c’est dans leur groupe d’âge que
ces nouvelles technologies sont les plus populaires —, on peut
conclure que les étudiants réclament des formules pédagogiques
impliquant le soutien d’un enseignant sur place et non un soutien
à distance.»
Ce résultat n’est pas pour déplaire aux quelque
30 chargés de cours en enseignement du français (unités
méthodologie, EDP, et mise à niveau, FRA), qui bénéficient
d’un lien d’emploi avec la FEP. «C’est notre
rôle d’enseigner le français, dit Mme Gamache. Nous
pressentions donc assez bien les faiblesses des étudiants.
Ce projet, initialement modeste, a pris de l’ampleur grâce
à l’appui de plusieurs partenaires.»
L’étude, intitulée «Les besoins en français
et en méthodologie des étudiants et étudiantes
de l’Université de Montréal», a coûté
35 000$ et a été financée par un «programme
d’intégration pédagogique des chargés de
cours». C’est le premier projet d’une telle envergure
résultant de ce programme, créé en 1996.
Une réponse rapide du vice-rectorat
Au vice-rectorat à l’enseignement de premier cycle et
à la formation continue, on a réagi rapidement aux conclusions
de cette étude. D’autant plus qu’une enquête
sur l’orientation de la formation de premier cycle a révélé
récemment un «large consensus parmi les unités
(N=50) voulant que l’UdeM mette en place des moyens pour aider
les étudiants à améliorer leur compétence
en langue française lue (70%), écrite (92%) et parlée
(84%)».
Les répondants à cette dernière enquête
— des vice-doyens aux études, directeurs de département
et d’école et responsables de programme — ont indiqué
qu’ils appuyaient en forte proportion les tests institutionnels
de classement à l’admission, les cours de français
non crédités donnés par l’Université
de Montréal et la formation de correcteurs compétents
pour assister les professeurs.
Le Centre de communication écrite, qui verra le jour d’ici
l’automne 2001, pourrait offrir un soutien aux professeurs surchargés
par la correction d’examens écrits; il viendrait également
en aide aux étudiants en cours de rédaction et proposerait
un site Internet de référence. Le Centre, doté
d’un comité scientifique consultatif, sera la partie visible
d’une politique de la maîtrise du français dans
l’apprentissage.
La mise en place de ce centre a été approuvée
par les membres de la Commission des études le 24 octobre dernier.
Au cours de cette séance, ils ont également donné
leur accord à plusieurs projets de création de programmes:
Diplôme d’études spécialisées en médecine
d’urgence (Faculté de médecine), Mention en études
allemandes dans le contexte européen (Faculté des arts
et des sciences), Concentration plasturgie au Département de
génie chimique et de génie mécanique (École
Polytechnique), Module de formation en gestion de l’invalidité
et de la réadaptation, Module de formation en échocardiographie
adulte et pédiatrique et Certificat d’intervention en
déficience intellectuelle (FEP). À la Faculté
de l’aménagement et à l’École Polytechnique,
les projets de modifications aux répertoires de cours ont également
été approuvés.
Mathieu-Robert Sauvé
![]()

