Volume 35 numéro 9 30 octobre 2000 |
Sexes
et pouvoirs en Iroquoisie
Le
pouvoir des femmes en Iroquoisie s’est accru par l’effet
de la colonisation, des guerres et des épidémies.
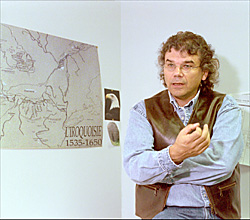 |
|
Deux visions s’affrontent
à propos du rôle et de la place des femmes chez les Hurons
et les Iroquois de l’époque précoloniale: celle
voulant qu’elles aient été les reines d’une
société matriarcale et celle voulant qu’elles aient
eu à assumer toutes les besognes.
Pour Roland Viau, ces deux visions relèvent du mythe. Selon
lui, la réalité se situerait quelque part entre les
deux: la société iroquoienne aurait été
une société «relativement égalitaire»
quant aux rapports entre hommes et femmes. C’est la thèse
qu’il développe dans son récent volume Femmes
de personne, Sexes, genres et pouvoirs en Iroquoisie ancienne.
 Professeur
au Département d’anthropologie et ethnohistorien de formation,
Roland Viau a parcouru l’ensemble de la littérature portant
sur la famille linguistique iroquoienne (incluant entre autres les
Iroquois, les Hurons, les Pétuns, les Neutres et les Ériés)
pour dresser un bilan critique de tout ce qui touche à la condition
des femmes dans cette culture. Il en tire une ethnographie de ce que
pouvait être la vie quotidienne de ces peuples au début
de la colonisation en misant sur les rapports entre hommes et femmes.
Professeur
au Département d’anthropologie et ethnohistorien de formation,
Roland Viau a parcouru l’ensemble de la littérature portant
sur la famille linguistique iroquoienne (incluant entre autres les
Iroquois, les Hurons, les Pétuns, les Neutres et les Ériés)
pour dresser un bilan critique de tout ce qui touche à la condition
des femmes dans cette culture. Il en tire une ethnographie de ce que
pouvait être la vie quotidienne de ces peuples au début
de la colonisation en misant sur les rapports entre hommes et femmes.
Deux mythes
Les premiers écrits relatant la vie et les moeurs des Amérindiens
nous viennent des missionnaires jésuites, des explorateurs
et des commerçants qui, fait remarquer l’auteur, n’avaient
pas un grand souci ethnographique. La description que fait Champlain,
par exemple, de la société huronne vers 1600 laisse
croire que les femmes font tout et que les hommes se limitent à
chasser et à faire la guerre:
«Ce sont elles qui ont presque tout le soing de la maison,
& du travail, car elles labourent la terre, ferment le Bled d’Inde,
font la provision du bois pour l’hyver, tillent le chanvre, &
le fillent, dont du fillet ils font des rets a pescher […] &
de plus sont tenuïs de suivre & aller avec leurs maris, de
lieu en lieu, aux champs où elles servent de mulle à
porter le bagage, avec mille autres sortes d’exercices.»
«À lire Champlain, on est porté à croire
que les tâches étaient inégalement réparties
dans l’économie iroquoienne et que les femmes huronnes
étaient infériorisées», souligne le professeur.
Cette vision des choses serait due au biais culturel androcentrique
des premiers Européens, qui n’auraient remarqué
que le labeur des femmes et pas leur rôle politique.
À l’opposé, 125 ans plus tard, le jésuite
Joseph-François Lafitau présente la société
iroquoienne comme un véritable matriarcat:
«C’est dans les femmes que consiste la Nation, la Noblesse
du sang, & de la conservation des familles. C’est en elles
que réside toute l’autorité réelle: le païs,
les champs & toute leur récolte leur appartiennent: elles
sont l’âme des conseils, les arbitres de la paix &
de la guerre: elles conservent le fisc ou le trésor public:
c’est à elles qu’on donne les esclaves. […]
Les hommes au contraire sont entièrement isolés &
bornez à eux-mêmes.»
Joseph-François Lafitau parle même de «gynécocratie»
et d’un «empire des femmes». Sa description sera
reprise 150 ans plus tard par l’ethnologue américain Henry
Morgan, qui ne partageait pas la vision du jésuite mais s’y
référait sans l’avoir lue. En 1884, Engels puise
dans la correspondance de Morgan des éléments soutenant
la thèse du matriarcat et qu’il inclut dans son célèbre
ouvrage L’origine de la famille, de la propriété
privée et de l’État. Le mythe était
né.
«L’examen critique des sources disponibles, les faits historiques
et les données ethnographiques ne s’avèrent pas
aussi probants quant à la suprématie de la femme en
Iroquoisie ancienne», écrit Roland Viau.
Gérontocratie
Le fait que les premiers missionnaires et explorateurs ont été
silencieux sur la supposée suprématie des femmes ne
peut s’expliquer, à son avis, par leur seul aveuglement
ou leur parti pris misogyne. «Si le pouvoir des femmes n’a
pas été décrit avant 1650, c’est probablement
parce que ce pouvoir n’existait pas et que la société
iroquoienne a évolué par la suite», avance-t-il.
L’auteur reconnaît toutefois qu’à l’arrivée
des Européens les Iroquoiennes jouissaient d’un statut
passablement plus enviable que celui des femmes des autres sociétés
ethnologiques de la même époque, et même des sociétés
occidentales. La transmission de la parenté et de l’appartenance
clanique se faisaient par la mère et les femmes contrôlaient
l’agriculture sans que les hommes leur disent quoi faire; «elles
étaient les femmes de personne, mais on était loin d’un
matriarcat».
«Le rôle déterminant dans l’exercice du pouvoir
appartenait aux aînés des deux sexes, précise
Roland Viau. Ce n’était pas une “gynécocratie”
mais une “gérontocratie”. La division sexuelle des
rôles était stricte, mais relativement égalitaire;
l’économie ne reposait pas sur l’exploitation d’un
groupe par un autre, mais sur la coopération entre les familles
et les sexes.»
La thèse centrale de l’analyse de Roland Viau est que
la colonisation va rompre cet équilibre et accroître
indirectement le pouvoir des femmes. «Alors que les épidémies
provoquent une crise démographique majeure, les guerres longues
et lointaines liées au commerce des fourrures entraînent
une absence de plus en plus prolongée des hommes. Les morts
sont remplacés par des captifs que les femmes ont pour tâche
d’enculturer. »
Ces éléments combinés conduisent à une
certaine hégémonie des femmes observée à
l’époque de Joseph-François Lafitau. Cette situation,
qui n’est pas à l’image de la société
préhistorique, va durer jusqu’au milieu du 19e siècle
alors que le travail salarié des hommes dans les chantiers
forestiers, la métallurgie ou les fabriques de canots vont
reléguer les femmes au second plan.
Autour de cette idée centrale, Roland Viau reconstruit la vie
quotidienne en Iroquoisie, présentant entre autres les mythes
de la création, la division des tâches, les moeurs et
la sexualité, l’idéologie et le pouvoir politique.
Daniel Baril
![]()

