Volume 35 numéro 4 18 septembre 2000 |
Pointe-du-Buisson:
5000 ans d’occupation et deux millions d’artefacts
Vingt-deux
ans de fouilles archéologiques à Pointe-du-Buisson ont
révélé le passé préhistorique du
sud-ouest du Québec.
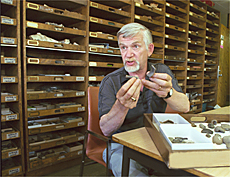 |
|
C’est extraordinaire,
exceptionnel, inouï, inimaginable!» Tous les qualificatifs
pourraient y passer lorsque le coloré Normand Clermont, professeur
d’archéologie au Département d’anthropologie,
décrit le site de l’école de fouilles de Pointe-du-Buisson,
à Melocheville.
C’est lui-même qui a mis sur pied cette école de
fouilles en 1977, la première et la seule à ce jour
consacrée à l’archéologie préhistorique
du Québec. Quelque 220 émules d’Indiana Jones se
sont ainsi succédé par groupes de 10 pendant 22 étés
pour apprendre, sur le terrain, les rudiments des techniques de fouilles,
allant de l’arpentage du site jusqu’au catalogage des pièces.
Au total, pas moins de deux millions d’artefacts ont été
tirés du sol: grattoirs, pointes de flèches, pièces
de poterie, hameçons, ossements, perles de colliers, pipes,
restes de nourriture, éclats de pierre, tout objet aussi modeste
soit-il devient, dans le langage archéologique, un «indice
matériel chargé de signification culturelle».
Ce matériel a déjà fourni la matière de
3 doctorats et de 12 maîtrises.
Malgré le nombre imposant de pièces recueillies, seulement
deux pour cent de ce site de 21 hectares (210,000 m2)
ont été fouillés. «C’est vous dire
la richesse et l’importance du site!» s’exclame Normand
Clermont.
 |
|
5000
ans d’histoire
Les artefacts exhumés du sol permettent de reconstituer la
préhistoire de tout le sud-ouest du Québec, incluant
l’île de Montréal. «Avant ces fouilles, nous
ne savions rien sur la préhistoire de la région, sinon
ce qui nous venait de la tradition orale», souligne le professeur.
Située à l’embouchure du lac Saint-Louis, où
le fleuve se transforme en rapides, Pointe-du-Buisson marquait un
arrêt obligatoire pour les voyageurs empruntant la route du
Saint-Laurent. De ce fait, l’endroit est extrêmement bien
représentatif de l’occupation méridionale préhistorique
du Québec.
«Il y a des traces d’occupations multiples et continues
remontant au moins jusqu’à 5000 ans», précise
M. Clermont. Cinq cents ans plus tard apparaissent les premiers indices
de la culture proto-iroquoienne, qui va évoluer vers la société
iroquoienne (incluant au Québec les Iroquois et les Hurons)
en place lors de l’arrivée des Européens.
Les plus anciennes pièces de poterie découvertes à
Pointe-du-Buisson datent de 3000 ans, ce qui indique que le début
de la domestication du milieu forestier (période sylvicole)
s’est effectuée à cette époque. La similitude
des pièces retrouvées dans toute l’Iroquoisie —un
territoire grand comme l’Angleterre et habité, à
l’arrivée des Européens, par 100,000 personnes
— montre également que ces populations étaient
nomades.
L’endroit n’a pas été qu’un lieu de passage,
il a aussi été un lieu de pêche. Entre l’an
500 et l’an 1000, les Iroquoiens deviennent semi-sédentaires
et des groupes d’une trentaine de personnes (hommes, femmes et
enfants) établissent, à cet endroit, un camp de pêche
d’été. «Les restes de poisson découverts
montrent qu’on y pêchait surtout la barbue, l’esturgeon,
la barbotte et le doré.» Les dépotoirs contiennent
également des ossements de castors, de chevreuils et d’ours,
signes d’une occupation plus longue.
Le tournant du premier millénaire marque aussi l’adoption
de l’agriculture. «On observe ce passage notamment par
les grains retrouvés dans les foyers, explique l’archéologue.
C’est ce qui permet de savoir que les Iroquoiens de cette époque
cultivaient entre autres le maïs, les haricots, la citrouille,
le tournesol et le tabac.»
Le passage à l’agriculture est accompagné d’une
sédentarisation accrue, ce qui est également observable
dans le sol de Pointe-du-Buisson. «Avec l’agriculture apparaissent
les premiers villages, qui sont pris en charge par les femmes pendant
que les hommes continuent d’aller à la chasse. À
ce moment, les Iroquoiens ne campent plus à Pointe-du-Buisson
parce que le sol glaiseux ne permet pas de semer; ils vont s’établir
autour du lac Saint-Louis et ne retournent à la pointe que
pour la pêche, qui devient une activité spécialisée.»
Des harpons, des hameçons d’os, des pesées de lignes
et même des bouts de filets découverts sur place en témoignent.
Les Français ont aussi laissé des traces sur les lieux.
«On a mis au jour des balles de mousquet et l’on sait,
par les écrits, que Frontenac y a campé. C’est
d’ailleurs un de ses amis, le baron de La Hontan, qui nous a
laissé la première carte, datée de 1752, où
figure le nom de Pointe-du-Buisson.»
À
la recherche d’un autre site
Même si l’endroit est loin d’avoir révélé
tous ses secrets, l’école de fouilles déménagera
l’an prochain. «Ce que le site renferme encore est inimaginable,
estime Normand Clermont, mais il faut aussi approfondir notre connaissance
des autres régions. De plus, ce site exceptionnel, où
les étudiants peuvent découvrir et apprendre en un mois
ce qui prendrait cinq ans ailleurs, n’est pas à l’image
des sites archéologiques habituels.»
Le prochain site pourrait se situer en Estrie, quelque part le long
de la frontière américaine. Un tel endroit permettrait
d’établir un trait d’union entre les connaissances
sur le sud-ouest du Québec et celles fournies par les sites
de la Nouvelle-Angleterre.
Daniel Baril
![]()

