Volume 35 numéro 3 11 septembre 2000 |
Internet
et littérature
Le
professeur Melançon propose une solution au problème
de la parcellisation de l’information dans Internet.
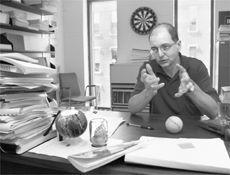 |
|
Le 24 juillet
dernier, Stephen King a offert aux internautes la version électronique
du premier chapitre de son nouveau roman, The Plant, pour 1$US. Il
s’agissait de sa deuxième expérience dans le commerce
en ligne. Le célèbre auteur américain a fait
un malheur dans le Net avec son livre Riding the Bullet: en
moins de 24 heures, plus de 400,000 personnes l’ont acheté.
«Le World Wide Web ne bouleverse pas que le monde de l’édition,
signale Benoît Melançon, professeur au Département
d’études françaises. L’impact de l’ordinateur
et du triple W nous oblige à nous interroger sur nos habitudes
de communication et de lecture.» Il ne s’agit pas d’un
effet de mode, ajoute-t-il. Depuis une trentaine d’années,
de nombreux chercheurs en lettres s’intéressent aux outils
offerts par l’ordinateur.
Aujourd’hui, l’ordinateur et le Web soulèvent de
nouvelles interrogations dans l’ensemble des études littéraires,
fait valoir le chercheur dans un article paru au printemps dans la
revue Études françaises. Le numéro Internet
et littérature: nouveaux espaces d’écriture,
tente de mieux comprendre les rapports entre l’ordinateur et
la littérature. Il réunit approches théoriques,
cas illustratifs et exemples de textes littéraires produits
directement par ordinateur (voir l’encadré sur le dernier
numéro de la revue).
Un
«vortail»?
Le professeur Melançon présente notamment dans cette
publication des Presses de l’Université de Montréal
une solution au problème de la parcellisation de l’information
dans Internet. «On a créé des moteurs de recherche
afin de faciliter la tâche des internautes, mais, même
avec un outil aussi performant que Google, il est encore difficile
de trouver une information précise. Résultat: on obtient
en une demi-seconde 20,000 références… pas toujours
pertinentes.»
De toute évidence, ce type de logiciel ne suffit plus. Le «vortail»,
un concept emprunté au monde du commerce, pourrait servir dans
le domaine de la recherche, estime M. Melançon. Qu’est-ce
qu’un vortail? C’est un site Web spécialisé
qui permet d’accéder par hypertexte à des sources
d’information sur un sujet particulier, explique-t-il.
«Plutôt que de passer par un seul moteur de recherche
ou d’employer les moteurs de métarecherche, [les internautes]
pourraient se rendre à ce portail au moment d’entreprendre
une recherche, écrit-il dans la revue Études françaises.
Il ne s’agirait pas de rassembler en un lieu toutes les ressources,
mais d’y regrouper les hyperliens y menant. Cela exigerait la
collaboration de ceux qui les gèrent et de ceux qui s’en
servent: ce portail ne serait viable que s’il était continuellement
enrichi et largement fréquenté.»
Un projet de cette nature se déroule au Centre international
d’étude du XVIIIe siècle de Ferney-Voltaire, en
France, auquel est associé le professeur du Département
d’études françaises. L’objectif n’est
pas de répertorier toutes les publications électroniques
dans le domaine de la littérature, mais de faciliter le travail
des dix-huitiémistes. Selon Benoît Melançon, l’élaboration
d’outils semblables est aujourd’hui nécessaire compte
tenu de l’utilité d’Internet et de son développement
effréné.
Le
courriel: confidentiel?
Internet change la nature même des études en littérature,
constate le professeur. «Vouloir le nier serait aussi absurde
que d’affirmer que la naissance de la photographie ou du cinéma,
pour prendre des cas similaires, n’a rien changé à
l’écriture littéraire. Lire à l’écran,
ce n’est pas lire un recueil de textes; sélectionner un
parcours de lecture hypertextuel ou se le voir dicter, ce n’est
pas suivre linéairement l’ordre des mots imprimés;
écrire à plusieurs, parfois dans l’anonymat, ce
n’est pas s’asseoir seul devant la page blanche.»
D’après Benoît Melançon, la notion même
d’auteur pourrait se transformer avec l’impact d’Internet.
Mais le lauréat du prix Raymond-Klibansky, de la Fédération
canadienne des sciences humaines et sociales pour son ouvrage sur
l’oeuvre épistolaire de Denis Diderot, n’est pas
contre le développement technologique. Chaque jour, il se sert
du courrier électronique.
Dans Sevigne@Internet, un essai paru en 1996 qui compare la
lettre traditionnelle et le courriel, M. Melançon aborde notamment
le problème de la confidentialité des échanges.
«La littérature regorge de cas où un tiers lit
une lettre qui ne lui est pas destinée. Le danger est le même
avec le courrier électronique. Ce qui change maintenant, c’est
la facilité de diffusion du message intercepté, l’ampleur
que cette diffusion peut connaître et sa rapidité d’exécution.»
David H., étudiant à l’École des hautes
études commerciales en France, l’a appris à ses
dépens. En quelques jours, un message envoyé à
des amis a été diffusé dans le monde entier et
a suscité la controverse; l’étudiant se plaignait
fort crûment d’une importante entreprise. Plus de 25,000
internautes ont visité le site intitulé «L’affaire
David H.».
Lorsque ce fait divers a attiré l’attention des médias,
une journaliste française a envoyé un courrier électronique
au professeur Melançon pour l’interviewer sur le sujet.
Comme il se trouve alors à Bangkok, c’est de la Thaïlande
qu’il répond à ses questions. Six mois plus tôt,
la même journaliste avait communiqué avec lui par courriel,
car elle le croyait à Montréal, pour obtenir une entrevue.
M. Melançon était en fait à Paris, à quelques
kilomètres du journal; il suggère de la rencontrer pour
discuter de vive voix de son ouvrage, publié aux Éditions
Fides.
«Morale de cette histoire? Si jamais j’actualise mon livre,
la question de la géographie tiendra une place plus importante
dans ma réflexion qu’elle ne l’a fait jusqu’à
présent. Pour moi, Internet est d’abord et avant tout
un outil indispensable qui incite à soumettre de vieilles questions
à un nouvel éclairage.»
Dominique
Nancy
Déconstruire le mythe des salons littéraires
«Ce ne sont pas seulement Julie de Lespinasse, la marquise du Deffand ou encore Mme Geoffrin, ces femmes intelligentes reconnues pour avoir tenu des salons littéraires dans le Paris de la fin du 18e siècle, qui attirent chez elles les personnalités des arts et des lettres. C’est surtout le pouvoir des habitués qui suscite l’intérêt. Chez la marquise du Deffand, par exemple, on note la présence de D’Alembert, secrétaire de l’Académie française.»
Celui qui s’exprime ainsi est Benoît Melançon, professeur au Département d’études françaises. Sceptique face au discours des manuels d’histoire de la littérature du 18e siècle, qui décrivent les salons littéraires comme des lieux de sociabilité intellectuelle égalitaire, il entreprend, sous un angle nouveau, l’analyse de textes de Marivaux, Diderot et Rousseau. Il tente de mettre en lumière comment la littérature en est venue à construire le lieu mythique que sont les salons littéraires.
«On se situe dans une société de l’Ancien Régime caractérisée par des normes aristocratiques, souligne le chercheur. Ce serait tout de même un peu étrange que n’importe qui puisse entrer dans un salon privé et prendre la parole pour faire valoir son talent. D’autant plus que l’influence des salons est particulièrement importante en ce qui a trait à la reconnaissance de l’auteur et dans le processus d’attribution des pensions et des places à l’Académie.»
Pourtant, le modèle du salon littéraire le plus convenu est celui d’une hôtesse distinguée recevant chez elle de grands esprits qui conversent et défendent, sans conflit, les valeurs dites fondamentales des Lumières. Certains hommes, comme le baron d’Holbach, ont aussi tenu des salons. Mais les manuels parlent peu d’eux et présentent un portrait idéalisé de ces rencontres entre lettrés et savants, déplore M. Melançon.
Son hypothèse de recherche pourrait bientôt se voir confirmer. Durant sa plus récente année sabbatique, il a passé quelques mois à Paris pour travailler dans les bibliothèques. C’est alors qu’il découvre un texte inconnu d’un dénommé Rutlidge. L’auteur y présente un point de vue antiphilosophique sur un salon littéraire de l’époque. «Il existe certainement d’autres écrits similaires, affirme le professeur Melançon. Il faut les trouver, car les salons du 18e siècle semblent caractérisés par des relations de pouvoir culturel tenues sous silence dans les ouvrages d’histoire de la littérature.»
D.N.
Presse et littérature
Qu’ont en commun Émile Zola, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers et Gilles Marcotte? Ce sont des écrivains et journalistes qui incarnent, de façon très diverse, la proximité entre activités littéraires et activités journalistiques, révèlent les professeurs Micheline Cambron et Hans-Jürgen Lüsebrink, respectivement de l’Université de Montréal et de l’Université Saarbrücken, en Allemagne.
«Reste que, dans la perception de l’histoire littéraire et culturelle, la partie journalistique d’une oeuvre d’écrivain apparaît généralement comme d’importance secondaire. […] L’appréciation inégale de ces pratiques et des rôles socioculturels auxquels ils renvoient dans le discours social reflète ce clivage», précisent les chercheurs dans un article publié dans le dernier numéro de la revue Études françaises.
Presse et littérature: la circulation des discours dans l’espace public s’interroge sur les rapports entre le sixième pouvoir et l’écriture littéraire. Trois angles y sont abordés: la place de la littérature dans les périodiques et son importance dans l’évolution de certains genres littéraires; le rôle et l’impact de la critique littéraire dans la presse; et, enfin, les interrelations entre l’écriture de l’écrivain et celle du journaliste.
L’ouvrage de 214 pages préparé par Mme Cambron et M. Lüsebrink comprend une dizaine d’articles de chercheurs universitaires d’ici, de la France et de l’Allemagne. Il réunit également les réflexions des critiques littéraires Gilles Marcotte, Thomas Steinfeld et Jean M. Goulemot sur les liens entre la littérature et l’espace public en mutation (voir l’article paru dans Forum le 12 avril 1999).
Le prochain numéro de la revue traitera de la construction du concept d’éternité dans le discours. Études françaises s’adresse principalement aux spécialistes des littératures française et québécoise, mais aussi à toute personne qui s’intéresse aux rapports entre les arts et les sciences humaines, les discours et l’écriture. L’ouvrage de critique et de théorie est en vente dans les librairies de l’Université et du quartier au prix de 12$. On peut aussi s’y abonner par le site Web des Presses de l’Université de Montréal: <www.pum.umontreal.ca/revues/revues.html>.
D.N.
![]()

