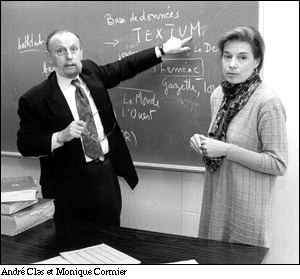 Le mot bathtub, qui
signifie «baignoire» en français de l'Académie,
est traduit au Canada français par «bain»,
tout simplement. «Comme dans "laver le bain",
illustre le linguiste André Clas, du Département
de linguistique et de traduction. Aucun Franco-Français
ne dira une chose pareille. C'est pourtant une expression courante
au Québec. Notre dictionnaire tiendra compte de cet usage.»
Le mot bathtub, qui
signifie «baignoire» en français de l'Académie,
est traduit au Canada français par «bain»,
tout simplement. «Comme dans "laver le bain",
illustre le linguiste André Clas, du Département
de linguistique et de traduction. Aucun Franco-Français
ne dira une chose pareille. C'est pourtant une expression courante
au Québec. Notre dictionnaire tiendra compte de cet usage.»
En collaboration avec la traductrice Monique Cormier, du même
département, il pilote la partie anglais-français
d'un imposant projet de dictionnaire canadien bilingue entamé
en 1994 et qui vient de recevoir un budget supplémentaire
de 2,1 millions de dollars sur cinq ans. L'Université d'Ottawa
assure la partie français-anglais et l'Université
Laval se penche sur les québécismes. En tout, quelque
20 000 mots ont déjà été étudiés,
traduits, indexés, sur un total de 100 000.
«Nous sommes l'un des seuls pays à ne pas posséder
un dictionnaire intégrant nos usages, explique Mme Cormier.
On trouve des dictionnaires de l'anglais australien, de l'anglais
américain, mais aucun dictionnaire bilingue canadien. C'est
quand même étrange pour un pays officiellement bilingue.»
Destiné aux traducteurs, aux linguistes et aux gens qui
désirent connaître le sens justifié par l'usage
des mots courants, ce dictionnaire reprend, par la force des choses,
l'ensemble du vocabulaire reconnu par l'Académie française
mais ajoute celui du terroir. Sous le mot «bain» déjà
évoqué, on trouverait les lettres CF entre parenthèses.
À «baignoire», les lettres FR. Mais cela va
plus loin. Nos concitoyens emploient le mot bathtub gin qui devient,
en français, «alcool frelaté». Le québécisme
est «bagosse». Tout cela doit figurer dans l'article.
«Nous serons forcés, dans certains cas, d'ajouter
plus de détails afin d'informer adéquatement le
lecteur, ajoute M. Clas. La difficulté, notamment avec
les jurons, sera de choisir les bonnes indications. Le juron "Christ",
par exemple, est-il "vulgaire" ou "familier"?»
Une base de données inédite
Au point de départ, tous les mots ont la même valeur
pour un lexicographe. Mais quand on doit consigner les mots d'une
langue dans un ouvrage, l'interprétation joue un rôle
non négligeable. «Il y a des différences linguistiques
notables entre les hommes et les femmes, note
Mme Cormier. Particulièrement en ce qui concerne les jurons.
Si l'équipe est majoritairement masculine, cela paraît.
Les femmes sont en général plus sévères.»
La pitoyable aventure du Dictionnaire québécois
d'aujourd'hui, lancé il y a quelques années par
Le Robert, est probablement due à de mauvais choix de mots,
estiment les chercheurs. Pour leur ouvrage, ils ont cherché
par tous les moyens à éviter ce piège. Une
base de données baptisée TEXTUM a été
créée; elle réunit les textes parus depuis
1990 dans plusieurs quotidiens (La Presse, Le Devoir, The Gazette,
The Toronto Star, The Vancouver Sun, Le Monde et L'Ouest) et l'intégrale
des oeuvres de la maison d'édition Leméac. En tout:
305 millions de mots.
Cet outil est innovateur, car, jusqu'ici, les dictionnaires étaient
écrits un peu instinctivement, en s'appuyant sur la mémoire
de leurs auteurs et sur le contenu de leurs ouvrages de référence.
En tout cas, on ne pourra pas reprocher aux lexicographes de cautionner
des mots peu courants. En un tour de main, grâce à
leur logiciel de navigation très efficace à travers
TEXTUM, ils font apparaître les centaines d'occurrences
du terme, la phrase où il s'intègre et la source.
Comme dans une langue vivante, c'est en quelque sorte l'usage
qui fait la règle.
La formation d'étudiants
Pour les 11 étudiants du Département qui font partie
de l'équipe, tous de deuxième ou de troisième
cycle, ce projet de recherche a deux atouts: il permet d'acquérir
une expérience tout en constituant une source de revenu.
Chaque assistant de recherche travaille ainsi de 10 à 15
heures par semaine à un tarif horaire de 10 $. «L'été,
paradoxalement, c'est notre grosse saison de production»,
ajoute M. Clas, qui estime le coût d'un dictionnaire à
quelque 15 millions.
En outre, cette équipe d'étudiants met actuellement
sur pied un colloque sur la lexicographie qui aura lieu durant
le congrès de l'ACFAS, au printemps prochain.
Dans l'évaluation que des pairs ont réalisée
pour le Conseil de recherches en sciences humaines, cet aspect
formateur méritait plusieurs éloges. «Le comité
a été impressionné par l'excellence de l'équipe
de recherche en ce qui concerne la formation des étudiants»,
écrivaient-ils avant d'approuver le financement de la seconde
phase du projet.
L'idée originale de ce dictionnaire, qui ne verra pas le
jour avant le prochain siècle (et dont le support papier
ne sera qu'un des moyens de diffusion), ne date pas d'hier.
C'est à un professeur de l'Université de Montréal,
Jean-Paul Vinay, qu'appartient la première tentative, en
1965, de réaliser un tel ouvrage. Cette initiative n'a
pas fait long feu, et l'idée a été reprise
par André Clas au début des années 1980.
Après avoir financé un an de travaux, le Conseil
de recherches en sciences humaines modifie sa politique. Pas question
de financer un dictionnaire. Pas assez «universitaire»...
Après deux tentatives infructueuses pour revenir à
la charge, André Clas abandonne. Il faudra attendre 1988
pour que Roda Roberts, de l'Université d'Ottawa, tente
sa chance et obtienne, à l'étonnement de tous, une
importante subvention pour lancer le projet actuellement en cours.
Mathieu-Robert Sauvé