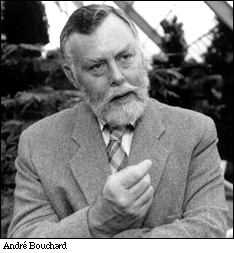 Autrefois, on trouvait
autour de Montréal de grands chênes, des pins blancs,
des hêtres, des pruches et des merisiers dans de vastes
érablières indigènes. Des arbres qui sont
pratiquement disparus de la région. L'activité humaine
est directement responsable de cette modification observée
partout dans le Haut-Saint-Laurent.
Autrefois, on trouvait
autour de Montréal de grands chênes, des pins blancs,
des hêtres, des pruches et des merisiers dans de vastes
érablières indigènes. Des arbres qui sont
pratiquement disparus de la région. L'activité humaine
est directement responsable de cette modification observée
partout dans le Haut-Saint-Laurent.
«On sait que les meilleures essences ont été
coupées les premières, jusqu'à épuisement»,
explique André Bouchard, professeur à l'Institut
de recherche en biologie végétale (IRBV). Avec son
étudiante Hélène Simard, qui en a fait son
sujet de maîtrise, il vient de publier un article sur cette
question dans le Canadian Journal on Forestry Research. «La
grande leçon que nous tirons de cette étude, confie-t-il,
c'est qu'il y avait autrefois, dans le sud du Québec, une
forêt très riche, sur les plans commercial et écologique.
C'est aujourd'hui une forêt appauvrie.»
Le défrichage de grands territoires à des fins agricoles
a bien sûr contribué à cet appauvrissement,
mais les ventes de bois pour le chauffage et la construction y
ont joué un rôle déterminant. On trouve au
Québec des données précises sur ce sujet,
car les transactions étaient souvent faites devant notaire.
Et comme le droit notarial défend aux professionnels de
détruire leurs archives, une mine d'information sommeillait
aux Archives nationales du Québec jusqu'à ce que
Mme Simard les parcourt.
Elle a consacré un an et demi à ce travail de moine.
«J'ai trouvé de tout. Même des preuves de la
vente d'esclaves, relate-t-elle. Probablement à cause de
leur analphabétisme, nos ancêtres avaient très
souvent recours au notaire. Cela nous a permis de savoir quelles
essences de bois étaient exploitées dans la région.»
La botanique mène à tout
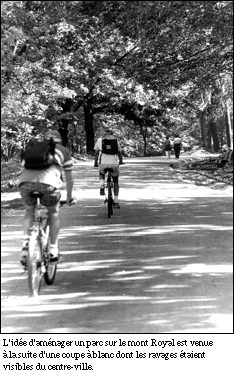 Au début du 19e
siècle, Napoléon impose un blocus sur les ventes
de bois dans le nord de l'Europe, où s'approvisionnait
l'Angleterre. Comme les États-Unis sont indépendants
depuis 1783, l'Empire se tourne du côté de ses colonies,
car la construction navale et residentielle bat son plein. «Entre
1806 et 1810, on sait que des bateaux repartaient d'ici avec des
madriers de chêne et de pin blanc», explique la chercheuse
de l'IRBV.
Au début du 19e
siècle, Napoléon impose un blocus sur les ventes
de bois dans le nord de l'Europe, où s'approvisionnait
l'Angleterre. Comme les États-Unis sont indépendants
depuis 1783, l'Empire se tourne du côté de ses colonies,
car la construction navale et residentielle bat son plein. «Entre
1806 et 1810, on sait que des bateaux repartaient d'ici avec des
madriers de chêne et de pin blanc», explique la chercheuse
de l'IRBV.
C'est tout de même le bois de chauffage qui a été
le plus exploité. «C'étaient les puits de
pétrole de cette période», rappelle M. Bouchard.
L'érable à sucre, le merisier et le hêtre
étaient particulièrement appréciés.
Mais selon les registres consultés, leur abondance diminue
progressivement avec le temps. «Les essences les plus dispendieuses
ont donc été exploitées les premières
et, au fur et à mesure qu'elles ont été épuisées,
elles ont été remplacées par d'autres, de
moindre valeur», conclut l'étude.
Recherches biographiques ou botaniques?
C'est par un hasard typique de l'histoire des sciences que le
botaniste a découvert cette source inusitée d'information
que constituent les archives notariales. M. Bouchard suivait les
traces d'un de ses ancêtres du village de Saint-Anisset,
Luc Hyacinthe Masson, déporté aux Bermudes pour
avoir participé à la rébellion des Patriotes,
en 1837. «Je cherchais à savoir à quel moment
il était arrivé là, quelles propriétés
il avait acquises, etc. En fouillant, j'ai compris que nos ancêtres
utilisaient le notaire pour toutes sortes de transactions.»
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ces archives cessent
d'être confidentielles après un siècle. Or,
on sait que l'essentiel du défrichage a eu lieu entre 1800
et 1880, période où tous les livres sont ouverts.
Ne restait plus qu'à parcourir les actes de la centaine
de notaires qui ont pratiqué dans la région du Haut-Saint-Laurent
à cette époque. Hélène Simard a relevé
448 transactions de bois sur quelque 500 000 actes.
Le plus drôle, là-dedans, signalent les chercheurs,
c'est que l'on ne peut pas faire de telles recherches ailleurs
dans le monde puisque nulle part ces conditions ne sont réunies:
défrichage sur une période bien délimitée,
utilisation massive des actes notariés, archivage...
Cela dit, l'étude compte tout de même des biais dont
les auteurs ne sont pas dupes. Les transactions des anglophones,
par exemple, ne donnaient presque jamais lieu à des actes
notariés, de même que l'utilisation du bois à
des fins domestiques: on a émondé d'innombrables
thuyas, par exemple, pour façonner des piquets de clôture.
Mais l'évolution des ventes de nos forêts en cordes,
madriers, bardeaux, bois équarri, planches, etc., n'en
donne pas moins une idée des essences disponibles à
l'époque.
Une seule forêt, actuellement, permet de se faire une idée
de la végétation dominante à l'époque
de la colonisation. Elle appartient à la famille Muir,
à l'est de Huntington, dont les ancêtres ont eu l'idée
révolutionnaire et fantaisiste d'en interdire l'accès
aux bûcherons. Un étudiant de M. Bouchard en a fait
la découverte il y a quelques années.
Même les espaces en apparence inviolés de la région
de Montréal, par exemple le mont Royal, ont subi d'importants
outrages. L'idée d'en faire un parc municipal, au milieu
du 19e siècle, a d'ailleurs jailli à la suite de
la décision d'un propriétaire de procéder
à une coupe à blanc qui était visible depuis
le centre-ville comme une large plaie sur son flanc.
Mathieu-Robert Sauvé