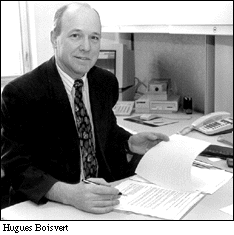 C'est une image radicalement
différente de l'image habituelle du financement universitaire
que nous propose Hugues Boisvert, professeur en comptabilité
de management à l'École des Hautes Études
Commerciales, dans son récent volume L'université
à réinventer.
C'est une image radicalement
différente de l'image habituelle du financement universitaire
que nous propose Hugues Boisvert, professeur en comptabilité
de management à l'École des Hautes Études
Commerciales, dans son récent volume L'université
à réinventer.
Le professeur a appliqué au financement universitaire la
méthode de comptabilité par activités consistant,
en gros, à redistribuer le budget d'une entreprise selon
l'importance relative de chaque activité accomplie par
toutes les catégories d'employés.
Cet ouvrage de 90 pages, que l'auteur qualifie d'essai, nous apprend
que la part du financement public (totalisant 2,407 milliards
de dollars en 1995) réellement consacrée à
l'enseignement et à la recherche est de 28 % et que celle
absorbée par les activités de soutien est de 72
%. Cette dernière portion constitue ce que M. Boisvert
appelle l'«université fantôme». Or, les
documents du ministère de l'Éducation (MEQ) indiquent
des proportions exactement inverses: 51 % iraient à l'enseignement,
21 % à la recherche et 28 % aux diverses formes de soutien.
Enseignement: 5 %
La conclusion spectaculaire de l'auteur avait tout pour attirer
l'intérêt des médias, mais pratiquement personne
n'a exposé la méthode. Un des principaux éléments
expliquant l'écart énorme est le fait que le MEQ
inclut dans «enseignement et recherche» une foule
d'activités qui n'en sont pas.
Hugues Boisvert nous apprend que, dans le 1,227 milliard soi-disant
consacré à l'enseignement, figure une partie des
sommes allouées à des activités comme le
soutien technique, le soutien de bureau et les métiers
ouvriers. On y trouve même un article «autres dépenses»,
totalisant 111,7 millions et incluant une partie des dépenses
d'électricité, de frais de déplacement, de
publicité et de mobilier.
Dans ce 1,227 milliard, la somme proprement consacrée aux
salaires des professeurs est de 692,5 millions de dollars (excluant
les 150 millions versés en avantages sociaux). Partant
de l'hypothèse que les professeurs consacrent en moyenne
une journée sur cinq à l'enseignement (une autre
à la gestion et trois au développement pédagogique
et à la recherche), Hugues Boisvert calcule donc 20 % de
692,5 millions pour obtenir une somme de 141,4 millions de dollars
réellement consacrés à la seule tâche
d'enseignement. (L'auteur inclut par contre les avantages sociaux
dans cette somme.)
Ces 141 millions ne constituent que 5,8 % du financement global
de 2,407 milliards de dollars. En effectuant le même type
de calcul pour les autres fonctions, il obtient 521 millions (soit
21,6 %) pour la recherche et 244 millions (10 %) pour la gestion.
Il reste donc une étonnante somme de 818 millions, soit
34 % du financement global, consacrée à des tâches
de soutien accomplies par d'autres personnes que les professeurs
et que le MEQ inclut dans «enseignement et recherche».
«Il s'agit d'un calcul approximatif, écrit l'auteur.
Cependant, je crois qu'il vaut mieux être approximativement
correct que précisément dans l'erreur du point de
vue de la gestion.»
Le volume laisse penser que la façon ministérielle
de ventiler le financement donne non seulement une image totalement
fausse de la réalité mais détourne des sommes
qui devraient être consacrées aux seules tâches
d'enseignement et de recherche. En entrevue, Hugues Boisvert nuance
toutefois son propos et reconnaît qu'il est impossible que
les professeurs ne fassent pas une part de gestion et que l'enseignement
ne peut pas être totalement coupé de son soutien.
«Mais ce que je remets en cause, précise-t-il, c'est
l'importance des sommes accordées aux autres fonctions
alors que le financement de l'enseignement et de la recherche
devrait plutôt correspondre à 60 % ou 65 % du financement
global.»
Nouveau mode de financement
L'autre élément important de l'essai de M. Boisvert,
bien que peu développé, porte sur un nouveau mode
de financement des universités. Au lieu de fonder le financement
sur le nombre d'étudiants, il propose comme base le salaire
des professeurs qui enseignent et font de la recherche.
Mais ceci s'avère n'être qu'un détour qui
nous ramène au critère actuel puisque le nombre
de professeurs «subventionnables» serait établi
en fonction du nombre moyen d'étudiants à temps
plein des trois dernières années. À ces deux
règles s'ajouterait un programme de subvention d'infrastructures
relatif aux équipements spécialisés.
Le comptable avance une simulation sommaire fondée sur
une subvention de base équivalant à deux fois le
salaire des professeurs «subventionnables». «Ce
n'est qu'une simple supposition», tient-il à préciser.
Cette forme de financement assurerait donc le paiement total des
activités primordiales des universités, soit l'enseignement
et la recherche, tout en assurant un montant minimal - au prorata
du salaire des profs - consacré aux activités de
soutien.
Les universités qui voudraient s'offrir plus que ce minimum
essentiel devraient miser sur les droits de scolarité,
qui pourraient varier de zéro jusqu'au montant jugé
nécessaire. Les droits de scolarité libéralisés
constitueraient donc un ticket modérateur pour les universités,
les amenant à alléger ou à abandonner des
activités que le professeur juge non primordiales: gestion
des règlements, organisation des horaires d'examens, gestion
des succursales et des déplacements, mise en marché
des programmes et des cours, amélioration du logement,
services aux étudiants et à la collectivité,
entreprises auxiliaires.
Ceci ne risquerait-il pas de créer des universités
de riches et des universités de pauvres? «Jusqu'à
un certain point oui, répond Hugues Boisvert. Mais c'est
un choix à faire. Si j'ai de l'argent, je pourrai me payer
le luxe d'une université qui offre un complexe sportif
ou même le logement gratuit. Si je n'en ai pas, je pourrai
choisir d'aller étudier gratuitement là où
il n'y a pas de droits de scolarité. L'important est de
maintenir l'accès aux études supérieures.»
Selon la simulation fondée sur le double de la masse salariale
des professeurs, M. Boisvert calcule que le financement public
global se situerait entre 59 % et 66 % du budget total de 2,407
milliards de dollars.
Toutefois, selon les chiffres fournis par le vice-recteur à
l'administration, Patrick Molinari, le montant consacré
aux seuls salaires des professeurs réguliers à temps
plein à l'U de M est, avec les avantages sociaux, de 125
millions. L'Université recevrait donc une subvention minimale
de 250 millions, alors que cette subvention n'est actuellement
que de 237 millions.
À la défense de M. Boisvert, il faut dire que les
chiffres de M. Molinari ne tiennent pas compte de la comptabilité
par activités.
L'université de rêve
 Tout au long de son
ouvrage, Hugues Boisvert dénonce l'«université
usine» développée selon un modèle industriel,
devenue une machine à produire des diplômes et où
la relation avec l'étudiant est une relation commerciale
avec un client. Par contre, son modèle d'université
allégée inspiré de l'approche dite lean organization
ou «organisation dégraissée» est lui
aussi calqué sur l'industrie, notamment sur les industries
automobiles américaine et japonaise.
Tout au long de son
ouvrage, Hugues Boisvert dénonce l'«université
usine» développée selon un modèle industriel,
devenue une machine à produire des diplômes et où
la relation avec l'étudiant est une relation commerciale
avec un client. Par contre, son modèle d'université
allégée inspiré de l'approche dite lean organization
ou «organisation dégraissée» est lui
aussi calqué sur l'industrie, notamment sur les industries
automobiles américaine et japonaise.
Il faut donc comprendre que ce qui est remis en question, ce n'est
pas tant l'alignement sur le fonctionnement industriel que le
type de gestion industrielle auquel on a recours.
Le professeur est tout de même convaincu qu'une cure d'amaigrissement
du côté du «superflu» serait de nature
à rapprocher les universités de ce qu'il estime
être l'«université de rêve» décrite
par le Conseil supérieur de l'éducation (CSE). Selon
le CSE, l'université doit se recentrer sur sa mission primordiale,
qui est de «diffuser, produire et conserver les connaissances».
Il admet en outre qu'il pose plus de questions qu'il n'apporte
de solutions. «Mon objectif était de présenter
un point de vue différent, de livrer une information nouvelle
et de stimuler la réflexion. Avant cette étude,
ajoute-t-il, j'aurais probablement agi comme le font les recteurs
présentement: réduire le nombre de professeurs,
augmenter leur tâche, augmenter le nombre de chargés
de cours et recruter plus d'étudiants. Avec ce que je sais
maintenant, j'agirais différemment.»
Daniel Baril